Les Maitres fous /Jean Rouch
Les Maîtres fous nous montre une cérémonie religieuse de la secte des Haoukas (ou Haukas) qui a vu le jour au Niger en 1927 et qui s’est répandue au Ghana – ex Gold Coast – vers 1935. L’essentiel de cette cérémonie, tournée trois ans avant l’indépendance du Ghana, est constitué de crises de possession collectives auxquelles se livrent des émigrants originaires du Niger et vivant dans la banlieue d’Accra. Ayant passé directement de la brousse à la ville, où plus exactement d’une civilisation traditionnelle à une civilisation moderne et machiniste, ils éprouvent des difficultés à s’adapter à ce nouveau mode de vie. Les crises de possession, qui convoquent les esprits Haoukas, agissent sur eux comme une thérapeuthique: elles leur permettent de mieux s’intégrer à cette vie nouvelle, tout en préservant leur équilibre et leur personnalité propre.
Fondé sur le phénomène de l’identification, ce rituel permet à la personne humaine d’être investie par une personnalité mythique ou légendaire qui agit à sa place. La possession fait de l’homme un reflet des dieux. Dans Les Maîtres fous, plus précisément, l’homme dominé puise son modèle chez le dominant. Les fidèles s’identifient aux personnages de l’ancienne hiérarchie britannique dominante (le gouverneur général, l’amiral, etc.), à travers une sorte de jeu cruel ou de théâtre excessif (Jean Genet s’est inspiré des Maîtres fous pour écrire ses pièces Les Bonnes et Les Nègres. Et Peter Brook s’est servi du film pour montrer à ses acteurs ce que peut être le déferlement de l’irrationnel dans le corps de l’homme.) Ce faisant, ils caricaturent les institutions occidentales et ils témoignent de l’influence néfaste exercée par le colonialisme. Le Noir devient le Blanc. Il est le Blanc et il agit comme tel. Les conduites qu’il exprime avec son corps, et qui suggèrent des signes et des symboles de participation, dévoilent un tissu de relations individuelles et sociales, imperceptibles autrement que par ce phénomène de transfert Des scènes très dérangeantes dans le film. Ainsi, nous voyons les initiés attendant que l’on apporte le chien du sacrifice (interdit alimentaire total). Nous voyons la bave, le tremblement de main, la respiration haletante des possédés. Nous voyons les Haoukas qui lèchent le sang. Puis vient le dépeçage du chien qui va finir par bouillir dans la marmite. A la suite de quoi, les Haoukas sortent la viande de l’eau bouillante et la mangent. Lorsque la crise est finie, les possédés se relèvent et partent. La nuit tombe sur la concession de Mountyéba. Le lendemain, dans les rues d’Accra, au quartier général des initiés, les possédés de la veille retrouvent leurs occupations habituelles. Ils ont résolu par les crises violentes, mais maîtrisées du culte des Haoukas, leur adaptation au monde d’aujourd’hui. En mai 1955, rappelle le magazine Sciences Humaines (août-septembre 2008, numéro 196), dans une salle du Musée de l’Homme à Paris, Jean Rouch montre Les Maîtres fous à ses collègues. Le cinéaste donne les explications depuis la cabine de projection. Sur l’écran, toute cette galerie de personnages mimant l’ordre colonial qui se dispute, sang aux lèvres, les reste du chien que l’on vient d’égorger. De sa cabine, Jean Rouch commence à percevoir les rumeurs de la salle. On y hurle, on y siffle. Marcel Griaule, le grand ethnologue français et directeur de thèse de Rouch, exige, « rouge de fureur », que l’on détruise le film. Paulin Vieyra, un étudiant dahoméen de l’Idhec (Institut des hautes études cinématographiques – aujourd’hui la Fémis) n’en demande pas moins. Scandale! Et ce n’est qu’un début, Les Maîtres fous provoquant de nouvelles empoignades au festival de Venise de 1957. http://youtu.be/vXI1g5WizoE Le film va attirer l’attention de la Nouvelle Vague. Et c’est ainsi qu’André Bazin, fondateur des Cahiers du cinéma, mesure l’ampleur du choc: « Ces « maîtres fous » ne sont-ils pas plutôt ou, mieux, simultanément des « esclaves raisonnables », je veux dire accomplissant leur emploi d’esclaves jusqu’à adorer la toute-puissance du maître? En eux la mythologie colonialiste s’accomplit au-delà de l’imagination« . Que Les Maîtres fous passionne, après tant d’autres, l’ethno-psychiatre Tobie Nathan n’étonne pas. Mais, ancien élève de Jean Rouch, un des premiers – sinon le premier – à lui avoir consacré toute une étude, je souligne plutôt ceci: Les Maîtres fous marque une étape essentielle dans l’histoire du cinéma direct (cf. L‘Aventure du cinéma direct, Gilles Marsolais, Cinéma Club/Seghers 1974). En ethnographe consciencieux, Jean Rouch enregistre un phénomène et essaie de communiquer le plus directement possible le fruit de ses observations à des gens qui appartiennent à une culture étrangère. Il apporte un message que les Africains n’avaient pas la possibilité d’apporter eux-mêmes.
Les Maîtres fous, 1953, Les Films de la Pléiade, 29 mn. Sonore, Couleur, 16 mn et 35 mn.

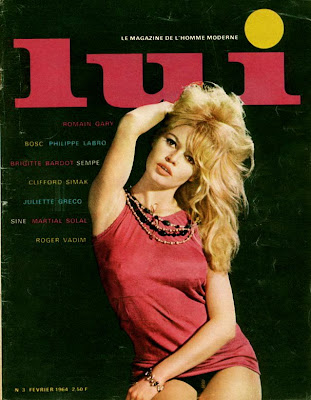
Commentaires
Enregistrer un commentaire