Jean Reverzy/ Le passage
Jean Reverzy meurt d’un infarctus du myocarde en 1959.
Dès les premières pages, à peine saisis, nous sommes plongés dans le grand bain Reverzy :
« Je suis médecin, et les médecins sont des gens pressés qui comptent leur temps et leur argent. Ils glissent dans un monde auquel ils ne participent qu’à demi ; un mur les sépare de la vie qu’ils surveillent. Pour eux, tous les êtres s’agitent en un coma permanent et, parce qu’ils la connaissent, ils se tiennent à l’écart de l’universelle agonie. Leur expérience est le résidu de souffrances aiguës et monotones. Dès l’aube, ils lèvent le drap du dernier mort de la nuit, puis errent parmi des formes qui se plaignent, qui pleurent, qui simulent. Après des années, ces témoins du passage et de la fluidité devraient aboutir au plus rigoureux désespoir. Mais le vieil inconscient humain les avilit ou les protège de trop de lucidité et ces spectateurs de toutes les angoisses ne sont pour la plupart que des petits épargnants. »
Soixante ans après sa publication, Le Passage frappe par sa sûreté de touche, sa densité, son acuité. À part quelques longueurs, rien ne laisse deviner l’œuvre d’un « débutant ». Nul tic d’époque ni avant-gardisme (nous sommes en pleine floraison de l’école française du Nouveau Roman) forcément daté. À condition de retirer à la notion de style le caractère de petite broderiesans conséquence, dont elle demeure entachée dans l’esprit de certains, on ne court pas grand risque à affirmer qu’on se trouve en présence d’un styliste accompli. Quelqu’un qui ne joue pas avec le langage, mais qui sait insuffler aux mots écrits la puissance et la précision qui les transformeront en armes auxquelles on n’échappe pas.
Un des traits saillants du roman tient à sa vision décapante des affairements humains, qu’ils se déroulent dans la salle d’attente d’un « petit docteur attaché à une banlieue triste de Lyon » ou dans les îles polynésiennes, dont le caractère « paradisiaque » est très vite mis en déroute dans l’esprit du lecteur.
Une lucidité âpre irrigue le récit. Ce pessimisme de l’intelligence prend sa source, on l’imagine, dans l’expérience de médecin généraliste, profession qu’exerça l’auteur après son internat dans différents hôpitaux deLyon et qui le mit très tôt au contact des « cadavres et des déjections humaines ». Ces circonstances, on peut le penser, ne furent pas sans effet sur la vision non évangélique de l’existence déployée dans Le Passage.
Au long des 13 chapitres de ce bref roman, la mort est à l’œuvre : des collines lyonnaises aux lagons de Polynésie, la décomposition accomplit son travail, inéluctable, immémorial ; avec une monotonie que Reverzy constate et décrit, s’autorisant plus ou moins de distance selon les moments.
Chez Reverzy, les lendemains qui chantent sont congédiés. Hier grince ou hurle. Aujourd’hui ne laisse percer ni lumière divine ni fraternité humaine. Les jours de gloire et les Grands Soirs ne figurent pas au programme. Reverzy ne tient pas boutique de farces et attrapes idéologiques. C’est, à l’époque, un phénomène assez singulier pour être souligné.
Étrangement – ou pas –, on éprouve une espèce de fraternité envers l’auteur, ce frère d’armes, qui nous dit que nous sommes cadavres en instance, serviles et fourbes, valets sans consistance et sans lucidité de la comédie sociale. On sait gré à sa noirceur vivifiante de ne pas offenser la nôtre, de ne pas se retrancher derrière les précautions diplomatiques ou les bonnes manières rhétoriques.
Même si une tendresse acide affleure ici ou là, nul n’est épargné. Ni les Tahitiens, « lourdauds et veules » ; ni les Chinois de Polynésie, décrits comme une masse d’insectes grouillants mus par la seule cupidité ; ni les « braves » tenanciers de l’hôtel où Palabaud (le livre raconte son retour à Lyon après un long séjour en Polynésie et ses retrouvailles avec le narrateur, un ami d’enfance) vient s’échouer : après un bref mouvement de sympathie, ils font appel à un « sous-chef inspecteur de la brigade des garnis » pour enquêter sur cet individu au parcours louche ; pas davantage les pontes de la médecine : « Le professeur Joberton de Belleville était le plus grand médecin de la cité. Tyran libéral, au faîte d’une médiocrité dès longtemps triomphante, il dominait un monde aux couleurs de poussière où l’intelligence sanglote comme une captive humiliée. » L’Église n’échappe pas au tir à vue : lors d’un épisode fondateur de son adolescence, Palabaud a eu maille à partir avec deux prêtres de son collège. On a trouvé sur lui un magazine pornographique. L’affaire s’aggrave avec la découverte d’un soutien-gorge de « satin noir » dans son pupitre. S’ensuit une scène de violence frénétique. Les deux ecclésiastiques, pris de fureur concupiscente envers l’adolescent, le rouent de coups de pied et de poing. Cela se termine dans le sang et l’hébétude honteuse, après que le jeune homme a fini par rendre les coups. Occasion pour le narrateur de laisser libre cours à la répugnance que lui inspire l’« odeur des prêtres », sur un mode dont la véhémence n’est pas sans rappeler le ton des libelles surréalistes de l’entre-deux-guerres :
« Il peut paraître également étrange que, toujours soucieuse du prestige de ses ministres, l’Église n’ait pas cherché à les débarrasser d’émanations somme toute fâcheuses pour les fidèles. Évidemment, un sujet puant n’a généralement pas conscience de la mauvaise odeur qu’il répand : c’est peut-être le cas de l’Église. D’ailleurs, une aération serait-elle possible ? L’odeur des prêtres remonte aux premiers temps. Ce remugle qu’ils traînent avec eux, d’entassements humains, de macérations dans une atmosphère souterraine n’est qu’un relent des catacombes : l’odeur même des siècles de l’Église. »
Seul Palabaud – obsédé par la mer, parti dès longtemps vers « les îles » et qui revient dans sa ville natale « pour y crever » d’une cirrhose non alcoolique, en compagnie d’une vahiné – est soustrait, dans une certaine mesure, au jeu de chamboule-tout.
« Dès sa sortie de l’enfance, les bruits des océans avaient guidé ses pas et ses regards. Impersonnel, toujours fatigué, il ne s’analysait guère mais parfois voyait assez loin pour discerner la profondeur d’un sentiment dont il ignorerait jusqu’au bout l’origine. L’appel insidieux avait eu raison de son effroi d’adolescent impressionnable pour l’arracher de la ville où l’idée d’un départ est un péché à l’égal du vol ou de la luxure et le pousser d’île en île jusqu’à l’hôtel des Mers-du-Sud. »
Jean Reverzy n’est pas un faiseur. Le caractère « clinique » du Passage épargne son auteur du soupçon d’opportunisme (la mode littéraire, après guerre, est au « noir »). Il y a une sincérité, une authenticité, chez lui ; que sa maestria n’étouffe pas. Nul oukase d’école ne le guide ; nulle complaisance à l’air du temps, à ce qui est en vogue. Il s’appuie sur sa sensibilité et sa probité intellectuelle. Il fait appel à ces mêmes facultés en nous. Il ne nous cantonne pas au rang de petits spectateurs passifs et moutonniers du massacre. Il nous invite – s’il convie à quoi que ce soit – à ne pas vivre à genoux sous les étroitesses et les arguments d’autorité.
Je ne prétends pas être en mesure de définir avec certitude ce qu’est un « grand livre ». Il me semble pourtant que Le Passage s’approche de cette zone obscure. (J’invite à lire tout Reverzy. Du Silence de Cambridge à À la recherche d’un miroir, recueil de textes brefs publié à titre posthume, en 1961, par Maurice Nadeau chez Julliard, rien n’est négligeable dans cette œuvre ramassée et dense.) C’est en tout cas l’impression que me laisse ce « roman » ardent et glacé, sans réponse ; où l’angoisse se mêle à l’enchanteresse étrangeté d’être et dont l’intérêt ne s’épuise pas avec l’intrigue. Sa frontalité, sa mélancolie, son apparente rugosité irriguée de percées poétiques, empoignent et creusent loin en nous, vers des rivages à la beauté sauvage et désolée :
« Nous étions passés l’un près de l’autre comme deux étrangers, comme deux animaux d’une espèce différente. En vain, je cherchai un sens à des mots que nous avions échangés, au contact de nos mains qui s’étaient serrées, aux rencontres de nos regards. Loin des océans et des îles, moi, le compagnon des agonisants, j’allais reprendre ma course au milieu d’immenses lassitudes, pensant une heure encore à Palabaud, mon nouvel ami parmi les morts. Je l’avais regardé vivre et mourir ; de son existence j’avais imaginé ce que je ne connaissais pas. Avant son retour, je pensais ne plus redouter la mort ; maintenant je la craignais moins encore. »
JEAN-PIERRE CESCOSSE
JEAN-PIERRE CESCOSSE
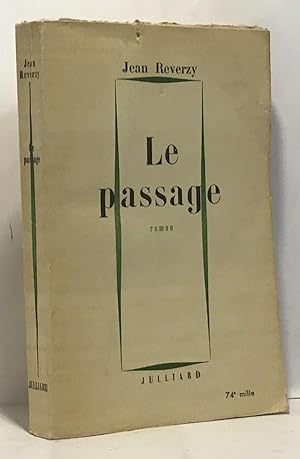


Commentaires
Enregistrer un commentaire